RUE DES KEBABS
PRESENTATION DU PROJET
Responsable scientifique : Catherine Gauthier
Les commerces de détails dans les centres anciens des petites villes à partir de l’exemple des kebabs.
À travers une analyse sociologique et architecturale il s’agit de comprendre les phénomènes et représentations liés au développement et à l’évolution des restaurants kebabs dans les quartiers populaires de centres anciens de 5 villes de la région AURA. Ce programme de recherche se décline en actions culturelles et pédagogiques, expositions, conférences, plateaux radio… visant un public hétéroclite.
 ©Sandrine Binoux
©Sandrine Binoux
Considérant l’implantation de certains commerces comme des indicateurs d’urbanité la présence des kebabs est souvent considérée comme un « trouble » de l’ordre public, esthétique, social, culture ; l’enquête essaie de restituer l’ordre de ces rues:
- Un ordre (cohésion sociale) qui relève plus de la veille sociale et du maintien de lien de sociabilités dans des quartiers défavorisés ou malmenés par les démolitions-reconstructions où il fait généralement défaut. On y relève une mixité sociale plus réelle que dans les grandes enseignes de fast-food ne proposant pas de viande hallal par exemple. En milieu semi-rural, le kebab reste également le signe du vivant, de la rencontre, de la convivialité, de la présence de la jeunesse.
- Un ordre public, de la régulation du désordre dans les usages de la rue, canalisant la délinquance par une veille aux jours et heures les plus creuses des quartiers populaires et petites villes de nos campagnes. Un code moral s’impose également au sein de ces commerces à la conduite des client-e-s, variable selon les temporalités.
- Un ordre commercial et de services : celui du libéralisme, de la concurrence par concentration, de l’ubérisation et dématérialisation de la consommation. Par ailleurs, si les enseignes crachent une lumière crue, c’est bien souvent la seule à demeurer allumée les dimanches, les jours fériés et au cœur de la nuit. L’animation de l’espace public est ainsi fortement liée à leur présence, ouverture ou fermeture.
- Un ordre urbain et/ou architectural : celui de pas-de-porte ouvert, de rez-de-chaussée assurant une certaine vitalité pour l’immeuble qu’il supporte, dans des territoires peu denses, particulièrement en quartier sensible, subissant une décroissance urbaine et économique. Ces rues dessinent dans l’espace urbain les axes d’une consommation singulière et d’une clientèle mobile et variée, tendus entre l’hyper-centre, ces centralités populaires et les périphéries et marges urbaines.
La réalisation d’un documentaire suit la logique d’une « anthropologie partagée » (Jean Rouch), posture assumée de l’anthropologue soumettant ses résultats en cours de tournage à ses interlocuteurs aussi variés soient-ils : le décideur, l’aménageur, le financeur, le commerçant, l’habitant, l’usager, le client, le touriste, l’éducateur, l’animateur ou le représentant associatif, l’électeur…
Au fil des rues marchandes de Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Montluçon ce travail cherche à interroger et croiser les différents regards portés sur ce qu’on appelle la « rue des kebabs ». Il tente de saisir les modes d’usage de ces lieux de consommation et de sociabilités ordinaires, tout en s’efforçant de comprendre comment ces commerces participent à la dynamique économique et sociale, et co-construisent l’image de villes en pleine mutation.
 ©Sandrine Binoux
©Sandrine Binoux
Partenaires financiers
L’ensemble de ce programme a été lauréat en 2019 et 2020 de l’appel à projet « Mémoires du 20e et du 21e siècle » financé par la DRAC et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Terrains, méthodologie et équipe
Films documentaires du projet de recherche Rue des kebabs
« Rue des Kebabs » est un documentaire réalisé par Catherine Gauthier, socio-anthropologue, avec des photographies de Sandrine Binoux et une bande son de Dan Charles Dahan.
Au fil de rues marchandes et de quartiers populaires des centres ville anciens de Saint-Etienne, Clermont-Ferrand et Montluçon (en région Auvergne-Rhône-Alpes), ce film cherche à interroger les différents regards portés sur ce qu’on appelle la « rue des kebabs ».
Il tente de saisir les ambiances diurnes et nocturnes et les modes d’usage de ces lieux de consommation et de sociabilités ordinaires. Il s’attache à comprendre comment ces commerces participent à la dynamique économique et social, et coconstruisent l’image de villes post-industrielles en transformation.
« Sur place ou à emporter ? » est un film photographique de 35 minutes, réalisé par Catherine Gauthier, Sandrine Binoux et Dan Charles Dahan, retraçant souvenirs et ambiances actuelles de cafés cosmopolites de cinq quartiers.
L’enquête montre comment la rue, l’usine, la vie migratoire les ont façonnés, puis comment leur activité déborde à son tour sur l’espace public par une animation très spontanée.
D’abord ressource urbaine pour les primo-arrivants, les cafés peuvent devenir aujourd’hui des emblèmes de la mémoire locale. Enquête et film permettent de visiter l’histoire des centralités commerciales en déclin et de rendre compte des traces encore vivantes d’une culture vernaculaire de la mixité socio-culturelle.
Communications et publications scientifiques

Gauthier. C
RESIDENCE DE RECHERCHE
2019 – 2020 – 2022 : Résidence de recherche à l’École Nationale Supérieure d’Architecture, Clermont-Ferrand
Médiation grand public
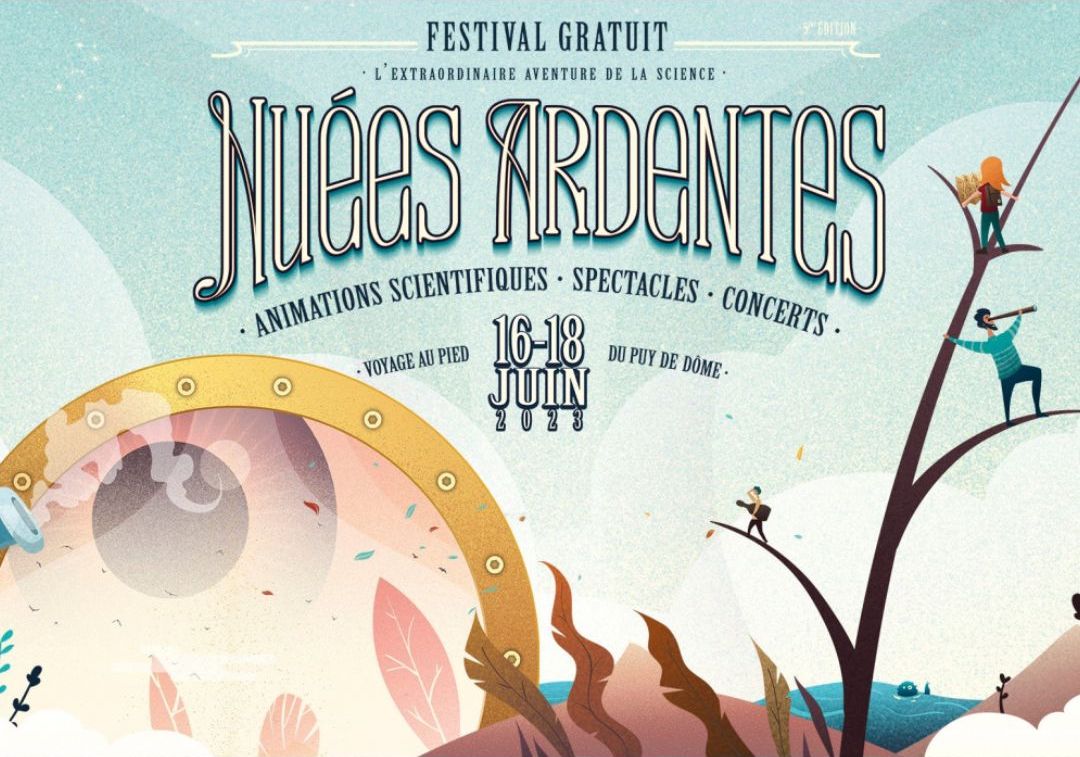
Gauthier. C
NUEES ARDENTES
16-18 juin 2023 : Projection du film « Sur place ou à emporter ? » au festival des Nuées Ardentes organisé par l’UCA en haut du Puy de Dôme
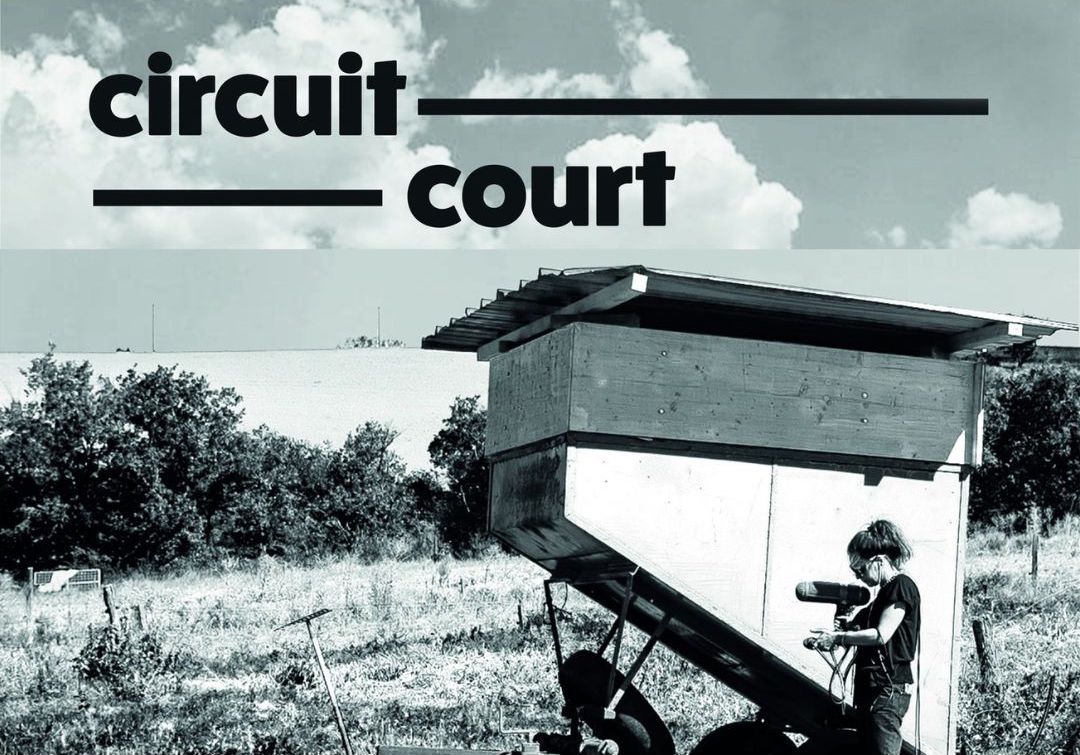
Organisé par cinéma le Mellies St François
CIRCUIT COURT
Mars 2022 : Projection de Rue des kebabs à « Circuit Court » au cinéma le Mellies à Saint-Etienne

Gauthier. C
L’ETONNANT FESTIN
18 septembre 2022 : Projection-débat avec Catherine Gauthier lors de l’Etonnant Festin

Organisé par le centre culturel le Bief
LES VITRINES QUI PARLENT
Mai 2022 : Animation et rencontre avec Catherine Gauthier autour du projet de recherche Rue des kebabs aux Vitrines qui parlent, le Bief à Ambert

Organisé par Traces
FESTIVAL DES IMAGES MIGRANTES
2021 : Expositions, projections, débats autour de « Rue des kebabs » à l’Amicale Laïque de Tardy, Saint-Étienne et au Château de Goutelas, Marcoux
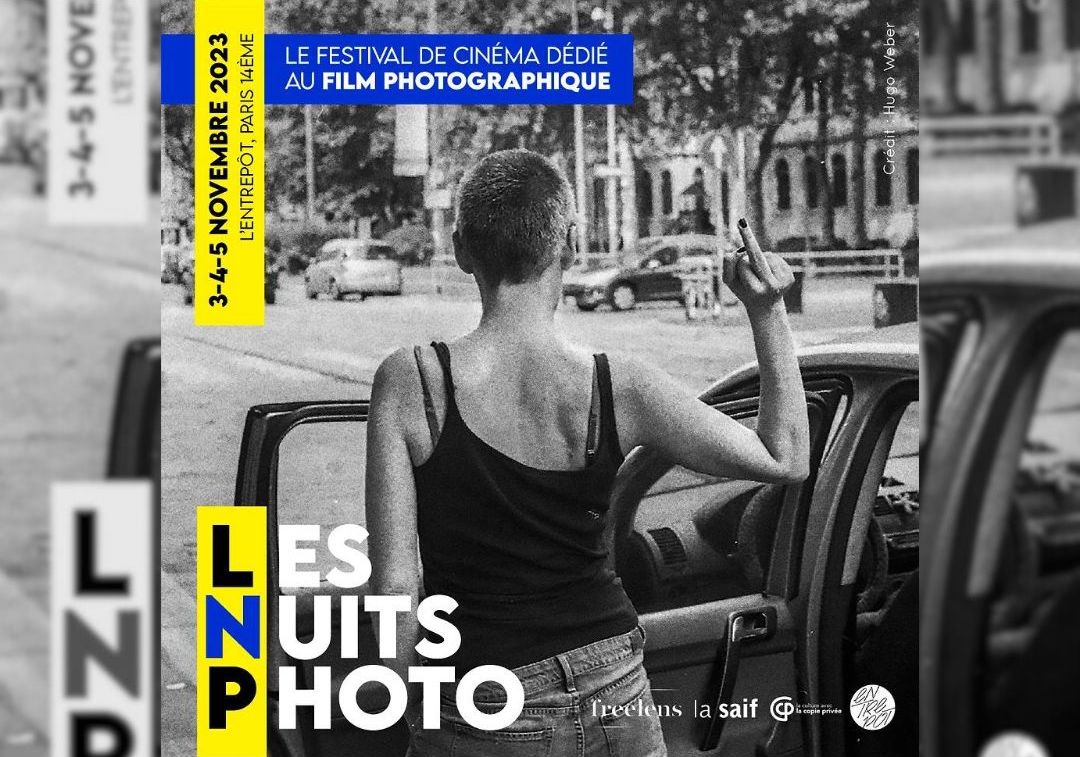
Gauthier C.
« LNP » LES NUITS PHOTO
6 novembre 2021 : Projection du film « Rue des kebabs » avec Catherine Gauthier aux Nuits Photographiques à Paris





